
Suzanne Grunberg - l'éclaireuse
Née en 1888 à Orléans d’un père employé de chemin fer et d’une mère sans profession, Suzanne Aupourrain étudie le droit et devient lorsqu’elle prête serment en 1909 la 9e avocate en France. Elle épouse en 1905 un médecin de nationalité roumaine, Orléans Grunberg, exerçant à Paris, avec lequel elle aura trois enfants.
En 1914, elle est appelée au Comité central de l’Union française pour la cause des femmes et participe durant toute la guerre à de nombreuses conférences sur la lutte contre l’alcoolisme, mettant en avant le calvaire des épouses et des enfants des hommes qui en sont atteints.
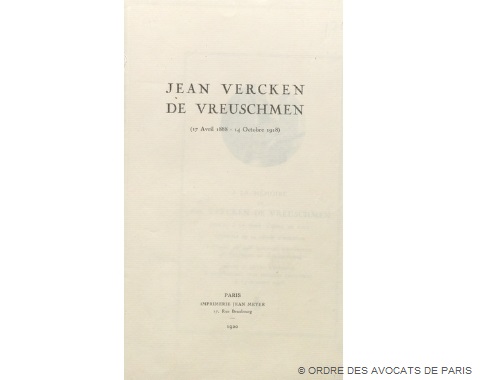
L'armistice de 1918 vu par Jean Vercken
Voici ce qu'écrivait Jean Vercken au sujet de la demande d'armistice des Allemands en 1918.
Au vu de leur situation sur les différents fronts, les allemands décident le 28 septembre 1918 d'organiser l'armistice.
Extrait du livre Jean Vercken de Vreuschmen, Imprimerie Jean Meyer, 1920 - Coll. Ordre des avocats de Paris.
Page 29 sur 39

